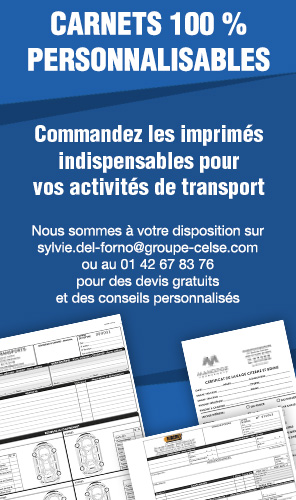Dans le monde du transport et de la logistique, la lettre de voiture tient une place centrale et incontournable. Il s’agit d’un document officiel ...
3.5.4 Conditions de travail et DE rémunération durant le délai-congé
● L’employeur et le salarié doivent observer leurs obligations réciproques (voir 2.3) jusqu’au terme du contrat de travail, et par conséquent pendant le délai-congé :
– l’employeur doit donc continuer à verser intégralement le salaire convenu, à moins que le salarié ne puisse assurer son travail (maladie : Cass. soc. 6-11-1975 ; départ au service militaire : Cass. soc. 19-12-1961…) et qu’une disposition conventionnelle ou un usage mette dans ces cas le salaire à la charge de l’employeur,
– l’employeur ne peut, du fait du congédiement, imposer au salarié un emploi différent (Cass. soc. 26-01-1966) ou modifier son régime de travail.
● Toutefois, dans certaines circonstances, l’employeur ne peut pas ou ne préfère pas utiliser les services du salarié pendant tout ou partie du délai-congé. Il lui est alors redevable d’une indemnité compensatrice de délai-congé égale au salaire convenu, correspondant à la période pendant laquelle le salarié n’a pas travaillé. Dans ce cas :
– la date effective de résiliation du contrat de travail ne se trouve pas modifiée ; elle ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ;
– si l’inexécution totale ou partielle du délai-congé résulte soit de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, soit du chômage partiel de l’établissement, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice est celui qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel (art. L. 1234-5 et 1234-9) ;
– l’indemnité est due même lorsque le salarié libéré de toute obligation retrouve un emploi rémunéré avant la date d’expiration du délai-congé,
– le montant de l’indemnité est calculé en tenant compte des avantages en nature (nourriture, logement…) ainsi que des accessoires variables ou fixes (commissions, primes…).
Par contre, doivent être exclues du calcul du salaire servant de base à l’indemnité de délai-congé, les indemnités qui représentent le remboursement des dépenses nécessitées par le travail (Cass. soc. 26-10-1945).
Les heures supplémentaires doivent entrer en ligne de compte pour le calcul du salaire servant de base à l’indemnité de délai-congé si ces heures supplémentaires effectuées au-delà du maximum légal « présentent, par la persistance de leur exécution, un élément stable et constant sur lequel les salariés étaient en droit de compter » et qu’ils auraient accompli, hormis le seul cas d’une circonstance imprévisible, s’ils étaient restés au service de l’employeur durant la période de leur délai-congé (Cass. soc. 20-10-1965).
● Le salaire correspondant au délai-congé – quelle que soit la durée de celui-ci – est passible de la taxe sur les salaires et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
L’indemnité de préavis est, comme le salaire (voir UD), incessible et insaisissable.
● Les conventions collectives ou les usages accordent souvent au salarié l’autorisation de s’absenter deux heures par jour pour chercher un autre emploi.
Ces deux heures sont rémunérées.
Il va de soi que le bénéfice de ce temps dont l’objet est la recherche d’un emploi n’est plus exigible lorsque cet emploi est trouvé.
– 12 heures rémunérées pour les ouvriers (CCNA 1, art. 5) ;
– 1 mois pour les employés (CCNA 2, art. 13) et les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 (CCNA 3, art. 17) ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (CCNA 3, art. 17) et les cadres (CCNA 4, art. 15).
Elles sont fixées d’un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour, par chacune des parties ; par accord des parties également elles peuvent être bloquées.
En l’absence de convention collective, si le salarié invoque un usage pour obtenir les deux heures, il doit prouver cet usage (Cass. soc. 15-11-1978).
Si le salarié renonce à l’exercice de son droit, il ne peut prétendre au paiement d’une quelconque indemnité compensatrice. Par contre, l’employeur qui refuse l’autorisation d’absence peut être condamné au paiement de ces heures à titre de dommages et intérêts.