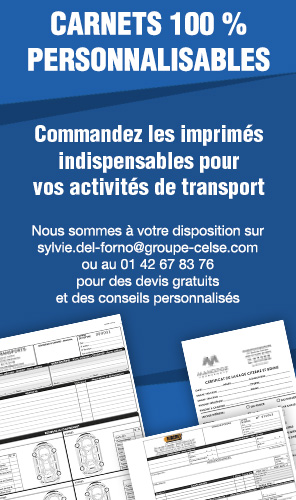Dans le monde du transport et de la logistique, la lettre de voiture tient une place centrale et incontournable. Il s’agit d’un document officiel ...
6.2.8. VALEUR JURIDIQUE DU PROTOCOLE NATIONAL SANITAIRE
Par un important arrêt Gisti du 12 juin 2020, le Conseil d’État a créé une nouvelle catégorie d’actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif : les documents dit « de portée générale », qui visent en substance, tous les documents de droit souple.
Trois critères sont posés par l’arrêt pour ouvrir la voie du recours en annulation :
– les documents doivent avoir une portée « générale » ;
– les documents doivent avoir été établis par des « autorités publiques » ;
– les documents doivent exercer une influence, en droit ou en fait, sur la situation des personnes concernées par le document litigieux.
Dans l’absolu, donc, des documents émanant des pouvoirs publics tels qu’un protocole national sanitaire, un questions-réponses, ou toute autre forme de communication normative peuvent être dotés d’une valeur juridique, ce qui implique qu’ils soient à la fois opposables aux justiciables (particuliers comme entreprises) et contestables en justice (qu’ils puissent donc faire l’objet de recours susceptibles d’aboutir, le cas échéant, à leur suspension ou à leur annulation).
Le protocole national sanitaire pose un ensemble de principes et de règles dont la mise en oeuvre par l’entreprise et les salariés établit le respect des principes généraux de prévention.
C’est donc notamment sur le fondement du contenu de ce document que des contrôles des services des Inspections du Travail seront susceptibles de s’exercer.
À cet égard, les termes du questions-réponses du Ministère du Travail quant à la valeur juridique du protocole national sanitaire sont sans équivoque.
Le protocole national sanitaire constitue un document opposable à l’entreprise et dont l’application s’impose à elle.
Il est ainsi explicitement énoncé : « Le protocole national, pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, est un document de référence établi par le ministère du Travail et constitue la norme sanitaire applicable dans les entreprises ». Les recommandations qu’il comporte « doivent être prises en considération par l’employeur pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention qui lui incombe en application de l’article L. 4121-2 du Code du travail ».
Il appartient à l’employeur par la voie du règlement intérieur ou par note de service portée à la connaissance de tous, de préciser – à la suite de l’analyse des risques effectuée et en privilégiant le dialogue social - les modalités permettant notamment la mise en oeuvre de l’ensemble des gestes et mesures barrière identifiés.
Enfin, il est noté que le protocole constitue également un document de référence pour l’inspection du travail.
Il semble résulter de ce qui précède que les entreprises qui ne respecteraient pas les règles et principes fixés par ce protocole national de déconfinement s’exposeraient en conséquence à une mise en cause de leur responsabilité (civile et pénale, le cas échéant), au titre notamment du non-respect des mesures générales de protection de la santé physique et mentale des salariés.
Le Conseil d’Etat administrative s’est prononcé à deux reprises, non pas sur le fond, mais dans le cadre de deux ordonnances de référé, sur la problématique de la valeur juridique du protocole national sanitaire.
La première décision du Conseil d’Etat est une ordonnance de référé datant du 19 octobre 2020.
Dans cette affaire, une demande de suspension du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise avait été formée le 23 septembre 2020 par une organisation professionnelle appartenant à la branche de la plasturgie.
L’organisation patronale considérait, notamment, que le protocole, en imposant l’obligation du port du masque en entreprise, méconnaissait le décret du 10 juillet 2020 en vertu duquel le port du masque n’est systématique que lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent pas être garanties).
Ces arguments ont été rejetés par la Haute Juridiction administrative, qui a affirmé qu’il n’existait pas de doute sérieux sur la légalité du protocole au regard de la généralisation du port du masque.
La Haute Juridiction administrative a énoncé : « le protocole constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de se l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du Code du travail ».
Le Conseil d’État a conclu son raisonnement en excluant toute nécessité de procéder à une quelconque suspension de la mise en oeuvre du protocole national sanitaire : « (…) dès lors qu’en l’état des connaissances scientifiques, le port du masque dans les espaces clos est justifié et constitue, en combinaison avec des mesures d’hygiène et de distanciation physique et une bonne aération/ventilation des locaux,
la mesure pertinente pour assurer efficacement la sécurité des personnes la suspension éventuelle du protocole n’aurait aucune incidence sur la mise en oeuvre pratique légale de l’employeur et sur la charge financière qui en résulte ».
Voir l’ordonnance de référé du Conseil d’État du 19 octobre 2020 :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-10-19/444809
Dans une seconde décision (l’ordonnance de référé du 17 décembre 2020), le Conseil d’État a, de nouveau, rejeté la demande de suspension du protocole sanitaire en entreprise formée par un syndicat patronal (le même), qui contestait le principe du recours généralisé au télétravail.
L’organisation professionnelle estimait principalement que le protocole était entaché d’incompétence, en ce qu’il affirme par principe le caractère obligatoire du télétravail dans le cadre de la crise sanitaire, alors que seul le législateur est compétent pour, dans le cadre d’un texte de loi, consacrer un tel caractère impératif du télétravail.
Mais le Conseil d’État a réaffirmé que le protocole national sanitaire « constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du Code du travail ».
Le Conseil d’État a estimé, à cet égard, que « l’obligation de sécurité impose à l’employeur de revoir, au vu des risques et des modes de contamination induits par le virus du Covid-19, l’organisation du travail, la gestion des flux, les conditions de travail et les mesures de protection des salariés » et que « l’appréciation du respect de cette obligation par l’employeur s’effectue nécessairement […] en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques en la matière ».
Ainsi, pour le Conseil d’État, « si certains termes du protocole sont formulés en termes impératifs », il a « pour seul objet d’accompagner les employeurs dans leurs obligations d’assurer la sécurité et la santé de leurs salariés au vu des connaissances scientifiques sur les modes de transmission du SARS-CoV-2 ».
La Haute Juridiction administrative est allée jusqu’à citer les éléments impératifs auxquels elle fait référence : « Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des salariés qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance ».
Pourtant, le juge administratif n’a attaché aucune conséquence juridique à ce caractère impératif, et s’est cantonné à proclamer que le protocole sanitaire en entreprise n’avait pas de valeur obligatoire mais constituait uniquement un référentiel (à travers un ensemble de recommandations) permettant aux employeurs de remplir leur obligation de sécurité dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Pour le juge administratif, le protocole a pour seul objet d’accompagner les employeurs dans leurs obligations d’assurer la sécurité et la santé de leurs salariés au vue des connaissances scientifiques sur les modes de transmission du SARS-CoV-2 et n’a pas vocation à se substituer à l’employeur dans l’évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention adéquate dans l’entreprise.
À cet égard, Le Conseil d’État observe que le questions-réponses sur le télétravail, publié sur le site internet du ministère du Travail dans sa version au 17 novembre 2020, indique « qu’il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre les principes généraux de prévention, qu’il lui incombe dans ce cadre d’évaluer les risques et de mettre en oeuvre des actions et moyens de prévention adaptés, que la mise en place du télétravail pour les activités qui le permettent participe des mesures pouvant être prises par l’employeur dans ce cadre et que l’employeur, qui reste tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié placé en télétravail, doit être attentif au risque de situations de souffrance pouvant en résulter pour les salariés isolés et leur permettre le cas échéant de venir travailler sur leur lieu de travail ».
Il résulte clairement des prises de positions de la Haute Juridiction administrative que, faute d’être doté d’une valeur normative, la méconnaissance du protocole national sanitaire ne peut donc pas, en tant que telle, être directement sanctionnée par les agents de l’inspection du travail.
Pourtant, le contenu du protocole sert de base et de référence à toute mesure de prévention des risques professionnels liés à la Covid-19 adoptée par les entreprises. Une entreprise désireuse de mettre en place des procédures spécifiques différentes de celles du protocole national sanitaire devra être en mesure de prouver que sa procédure lui permet de respecter son obligation générale de préservation de la santé et de la sécurité des salariés.
Il doit également être relevé que la Haute Juridiction administrative a précisé qu’une éventuelle mise en demeure ou sanction émanant de la DIRECCTE à l’encontre d’une entreprise connaissait un unique fondement légal : l’obligation pour l’employeur d’évaluer les risques et de mettre en oeuvre des moyens de prévention adaptés (article L. 4121-1 du Code du travail).
Voir l’ordonnance de référé du Conseil d’État du 17 décembre 2020 :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-17/446797