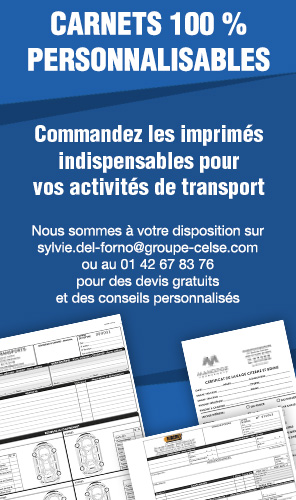Dans le monde du transport et de la logistique, la lettre de voiture tient une place centrale et incontournable. Il s’agit d’un document officiel ...
1.1.3.4.1.1.2 Accidents de trajet
Est accident du trajet, tout accident survenu :
– sur l’un des parcours définis comme parcours ;
– dans le temps et les délais normaux de ces parcours ;
– à l’occasion de déplacements en rapport direct avec les exigences du travail qui va ou vient de s’accomplir, sans qu’il y ait rupture ou suspension du contrat de travail.
L’accident de trajet se distingue de l’accident du travail au sens strict sur quatre points :
– définition minutieuse par le Code de la Sécurité sociale ;
– interprétation restrictive de cette définition alors que les juges sont, plutôt libéraux en matière d’accident du travail ;
– nécessité pour la victime de faire la preuve d’un accident répondant à la définition légale (pas de présomption…) ;
– possibilité d’une réparation complémentaire même si le tiers responsable est un collègue de travail de la victime.
Constitue un accident du travail (et non de trajet) l’accident survenu au cours des déplacements « résidence/entreprise » obligatoirement effectués à l’aide du moyen de transport mis à disposition par l’employeur et rémunérés par ce dernier.
Sont des accidents de trajet, les accidents survenus à un salarié à employeurs multiples en se rendant d’une entreprise à l’autre8.
● Parcours protégé
Il s’agit du trajet normal d’aller et de retour…
Mais ces parcours différents ne doivent être ni interrompus, ni détournés pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
1. Il en résulte que les accidents de circulation à l'intérieur de l'entreprise sont des accidents du travail et non de trajet.
2. Encore faut-il que le salarié ne se place pas hors du champ de l'autorité patronale : grève, travaux personnels, collecte du sang, etc. Mais les délégués sociaux peuvent bénéficier de la législation AT dans l'exercice de leurs fonctions même s'ils sont grévistes.
3. Si la nourriture constitue un élément du contrat de travail, la cantine, même extérieure à l'entreprise, peut être considérée comme lieu de travail. Le repas d'affaires peut également être considéré comme professionnel mais la jurisprudence est exigeante.
De toute façon, la prise en charge de l'accident n'est pas automatique. Ainsi n'a pas été qualifié AT, l'accident survenu à un salarié en ouvrant une boîte de conserves apportée à la cantine pour le repas ou en se livrant à une activité étrangère à la destination normale du réfectoire et contraire aux consignes qui en régissent l'usage.
4. Exemple : l'intoxication, par oxyde de carbone et pendant son sommeil, d'un conducteur routier obligé, en raison de mauvaises conditions atmosphériques, de coucher à l'hôtel (Cass. soc. 30 mai 1973). Inversement, le représentant victime d'un accident, après avoir été invité par son client à un vol aérien, ne peut bénéficier de la législation AT (Cass. soc. 8 mai 1980).
5. Cette règle supprime juridiquement les accidents de trajet au cours de l'exécution de toute mission. Son application est tempérée par l'exigence du caractère exceptionnel de la mission et une appréciation restrictive des trajets inclus dans l'exercice normal de la profession.
6. Un cadre dirigeant victime à son domicile d'une agression, en relation évidente avec ses fonctions, ne peut cependant être considéré comme étant en permanence au service de l'entreprise et ne saurait donc être, dans cette circonstance, pris en charge au titre des AT (Cass. soc. 29 octobre 1980).
7. Si le suicide jugé « décision réfléchie », est considéré comme la conséquence directe d'un accident, le caractère professionnel lui est reconnu (Cass. soc. 23 septembre 1982). Si, au contraire, le suicide apparaît totalement étranger à tout accident antérieur et au travail exécuté ce jour-là, la conclusion est inverse (Cass. soc. 4 mai 1982).
8. Les accidents survenus aux salariés lors de détours effectués dans le cadre d’un covoiturage régulier entre le domicile et le lieu de travail sont assimilés à des accidents de trajet (art. 27, loi 17/07/2001 - art. L. 411-2 C. Séc. soc.). Un accident survenu dans le cadre d’une mission pour l’employeur est qualifié accident du travail pendant tout le temps de la mission.
9. Sont assimilées à la résidence, ses dépendances immédiates (paliers, escaliers, cour, jardin, etc.) à condition qu'elles fassent partie du trajet obligatoire.
10. Ceci exclut les lieux de séjour épisodique et ceux où s'accomplit un acte passager (exemple de la visite du salarié au chevet de sa mère malade).
11. Il s'agit du lieu d'exécution du contrat résultant des directives de l'employeur (exemple : centre de formation si le salarié bénéficie d'un stage dans le cadre du plan de formation de l'entreprise).
12. Le lieu doit être fréquenté avec une certaine périodicité. N'est pas « couvert » le trajet entre la cantine et l'établissement où le salarié a l'habitude d'aller prendre seulement son café…
Est considéré comme normal, l'itinéraire habituel, en principe le plus court1.
Il y a détournement lorsque le salarié quitte l'itinéraire normal, ce qui supprime la garantie légale de prise en charge AT2.
Mais, s'il est causé par les nécessités de la vie courante et de l'emploi, le détournement ne fait que suspendre cette garantie jusqu'à l'endroit où le salarié reprend son trajet normal3.
Tel est le cas, par exemple, d'un détour effectue4 :
– pour raccompagner un collègue de travail en l'absence de moyens normaux de communication ;
– pour accomplir les formalités nécessaires à la sortie de maternité de l’épouse ;
– pour effectuer des achats chez le boulanger, le boucher, le pharmacien ou au bureau de tabac.
Le trajet peut, aussi, être prolongé ou dépassé, ce qui exclut la garantie5.
● Temps du parcours
La qualification d'accident du trajet implique que l'accident se produise dans le temps normal du trajet6. Si la durée de ce trajet est anormale sans cause justificative, il n'y a pas AT.
L'interruption s'apprécie par rapport à la durée totale de ce trajet. Il n'y a pas AT lorsque l'accident se situe pendant l'interruption (arrêt dans un magasin ou dans un café), sauf si cette interruption se produit sur le parcours normal (cyclomotoriste descendu de machine pour voir un camion immobilisé sur la chaussée).
Mais s'il s'agit des nécessités de la vie courante et de l'emploi, l'interruption ne fait que suspendre la garantie légale jusqu'au moment où le salarié reprend son trajet normal.
Tel est le cas, par exemple, du fait d'acheter un journal, d'effectuer les emplettes familiales quotidiennes ou de refaire en sens inverse le trajet pour aller chercher une musette égarée en cours de route7.