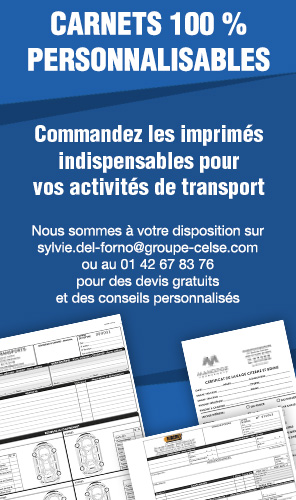Dans le monde du transport et de la logistique, la lettre de voiture tient une place centrale et incontournable. Il s’agit d’un document officiel ...
Art. L. 1331-2 et L. 1334-1 C. trav.
Les amendes ou tout autre sanction pécuniaire sont interdites.
Il est interdit à un employeur de sanctionner un salarié par une sanction pécuniaire. Toute disposition contraire (contractuelle ou conventionnelle) est nulle. La violation par l’employeur de ce principe constitue une infraction pénale punie d’une amende de 3 750 € et, en cas de récidive, d’une amende de 7 500 €.
Cependant, la loi ne définit pas précisément la notion de sanction pécuniaire. Les juges ont donc dû préciser la portée de l’interdiction édictée par le législateur. D’une manière générale, d’après les circulaires interprétatives de l’administration et, surtout, d’après la jurisprudence, la sanction pécuniaire peut s’entendre de toute mesure, affectant directement ou indirectement la rémunération, prise par l’employeur en raison d’une faute du salarié alors que celui-ci « a normalement fourni sa prestation de travail ».
Par exemple, ont été jugées comme des sanctions pécuniaires illicites :
– le fait de ne pas verser son salaire à une employée en raison de la non-remise de ses fiches de travail ;
– le retrait au détriment d’un salarié d’un avantage en nature en raison de résultats considérés comme insuffisants ;
– la privation d’une prime de fin d’année en cas de faute grave, d’une prime d’objectif en cas de licenciement pour faute, ou d’une prime de rendement en raison d’une faute et non pas d’un moindre rendement ;
– les retenues sur salaire opérées en raison d’une mauvaise exécution du travail, d’un manque de motivation ou d’un manquement aux obligations contractuelles. Sont plus particulièrement prohibées les retenues sur salaire pour erreur de caisse, pour
remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié, ou encore pour refus
d’assister à une réunion…
Cette liste n’est pas exhaustive. Cela signifie que ces comportements fautifs ne peuvent pas être sanctionnés. Le principe législatif signifie tout simplement que l’employeur ne peut sanctionner le salarié par une diminution de sa rémunération, quelle que soit l’origine de cette rémunération (contractuelle ou conventionnelle).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2015, a rappelé l’interdiction de sanctionner un salarié responsable d’un accident de voiture pécuniairement : cela est illégal, interdit par le Code du travail (art. L. 1331-2).
En l’espèce, un accord d’entreprise fixait une prime de non-accident. L’accord prévoyait que cette prime n’était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d’un accident de la circulation.
Les juges ont estimé que, par ces dispositions, l’accord instituait une sanction pécuniaire : ils ont considéré que c’était bien un motif disciplinaire qui justifiait le non-versement de la prime et en ont déduit qu’il s’agissait d’une sanction pécuniaire illégale.
Il résulte de cet arrêt qu’un accord collectif (quel que soit le niveau auquel il est conclu) ne peut en aucun cas prévoir la possibilité d’une retenue sur salaire à titre de sanction disciplinaire (l’employeur ne peut évidemment pas le prévoir non plus, ni par une note de service, ni par son règlement intérieur, ni même par accord avec le salarié).