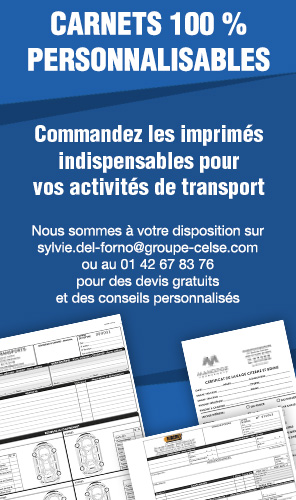2 Durées des temps de service
1. Principes
Le nouveau dispositif mis en place définit, en conservant le principe des équivalences, combiné avec la rédaction du nouvel article L. 212-18. 2° c) du Code du travail, des durées de référence et des durées maximales de temps de service distinctes et supérieures à celles de la durée légale du travail effectif.
Ces durées sont variables selon les catégories de personnels roulants concernées.
La réglementation impose trois repères de durées de temps de service des personnels roulants, sur la base desquelles il convient d’apprécier le respect des normes qu’il fixe :
– la durée quotidienne (article 7 § 3),
– la durée hebdomadaire (article 5 § 3),
– la durée trimestrielle ou, en cas d’accord, quadrimestrielle (article 5 § 3).
2. Repères
A) Durée quotidienne
Pour tous les personnels roulants, la durée quotidienne maximale de temps de service est supérieure à la durée du temps de travail effectif (10 heures) dans la limite de 12 heures et dans le respect des autres normes de temps de service sur la semaine et le trimestre (ou le quadrimestre).
Le décret du 7 janvier 2007 supprime le dispositif de limitation à 6 fois par période de 12 semaines la possibilité de porter au maximum à 12 heures deux fois par semaine la durée du temps de travail, sauf pour la seule catégorie des personnels non sédentaires du déménagement, c’est-à-dire ceux qui n’appartiennent ni aux personnels roulants (personnels de conduite et autres personnels de déménagement à bord du véhicule) ni aux personnels sédentaires (il s’agit pour l’essentiel des personnels commerciaux).
B) Durées de temps de service de référence et maximales hebdomadaires et trimestrielles (voire quadrimestrielles)

Pour l’appréciation des durées de temps de service maximales sur une période supérieure à la semaine le décret introduit une nouvelle distinction selon que le transport est effectué ou non avec des véhicules de plus de 3,5 t de PTAC au sens de la réglementation communautaire.
Il convient de considérer, au regard de la rédaction du texte, que l’application des normes les plus restrictives doit se faire dès lors qu’au cours de la période de décompte du temps de travail retenue dans l’entreprise le conducteur considéré utilise au moins une fois un véhicule de moins de 3,5 t.
Par cette référence au tonnage du véhicule, il s’agit de tenir compte de la distinction de régime juridique et de normes applicables aux personnels de conduite du fait que selon le tonnage du véhicule utilisé ils relèvent du champ d’application de la Directive 2003/88/CE (– 3,5 t) ou de la Directive 2002/15/CE (+ 3,5 t).
Dans la directive 2003/88 les normes sont plafonnées à 48 heures de travail effectif pouvant être appréciées sur 4 mois au plus (soit 830 heures) tout temps compris, c’est-à-dire en tenant compte des heures d’équivalences prévues par la réglementation nationale.
Dans la directive 2002/15, bien que la durée maximale hebdomadaire de travail moyenne sur 4 mois de 48 heures par semaine soit également applicable, compte tenue des éléments constitutifs qu’elle retient au titre du temps de travail, celle-ci permet en réalité de fixer au plan national des durées supérieures (53 heures ou 689 heures ou 918 heures selon la période de décompte).
En effet, celle-ci retient moins d’éléments que ceux pris en compte au plan national au titre du temps de service, à savoir :
– le temps de conduite ;
– le chargement, déchargement ;
– l’assistance aux passagers, le nettoyage et l’entretien technique ;
– tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule du chargement et des passagers ou à remplir des obligations légales ou réglementaires liées au transport spécifique en cours (contrôles, formalités administratives...) ;
– les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à
son poste de travail prêt à entreprendre son travail, les périodes d’attente lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance.
Elle ne retient pas, en revanche les temps de disponibilité durant lesquels le travailleur n’est pas tenu de rester à son poste mais doit être disponible pour répondre aux sollicitations éventuelles de son employeur et dès lors que le travailleur en connaît à l’avance la durée prévisible.
Concrètement, il faut donc veiller au respect des deux normes.
3. Décompte du temps de service, périodes de décompte
Le principe posé par le décret reste le décompte de la durée hebdomadaire du travail sur la semaine.
Cependant un décompte de la durée hebdomadaire du travail sur une durée supérieure à la semaine est possible :
– par application d’un accord de modulation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du Code du travail, imposant le respect de la durée moyenne de temps de service de référence
des personnels roulants (43 heures ou 39 heures ou 35 heures selon les personnels) ou de la durée légale pour les autres personnels ;
– par application, conformément à article L. 212-18 du Code du travail, et toujours pour les seuls personnels roulants, d’un accord collectif étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement permettant de déroger aux dispositions relatives à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires et, ce, dans la limite de quatre mois ;
– par application directe du décret du 4 janvier 2007 et pour l’ensemble des personnels roulants (grands routiers, longue distance, autres personnels roulants ou conducteurs de messagerie), mais à défaut d’accord dans les conditions précitées et
conformément à l’article L. 212-18 nouveau du Code du travail, qui autorise un décompte de la durée du travail de droit sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite de trois mois. Le trimestre étant défini comme toute période de trois mois débutant impérativement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre et qui correspond à une période de 13 semaines consécutives (le quadrimestre est défini comme toute période de quatre mois à partir du 1er janvier, du 1er mai ou du 1er septembre).
Dans cette dernière hypothèse, l’étalement sur une période d’au plus trois mois du décompte de la durée du travail des personnels roulants est de droit.
Les entreprises peuvent toutefois retenir une autre période multiple de la semaine en fonction de leur organisation et de leur rythme d’activité puisque le trimestre constitue la période d’appréciation maximale, en revanche elles ne peuvent opter pour une autre répartition trimestrielle que le trimestre civil.
La mise en place de cette nouvelle période de décompte, hormis le quadrimestre qui se fait par accord collectif, requiert une simple consultation pour avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent, sans autre formalité. Il n’y a plus non plus à requérir l’autorisation de l’inspecteur du travail alors qu’elle devait l’être sous le régime précédent.
NB. Cependant, dans bien des situations, cette mise en place devra amener l’entreprise à vérifier quelle est la source juridique à l’origine du régime de décompte précédemment pratiqué afin de respecter les règles et procédures de modification des textes jusqu’alors appliqués (utilisation d’un accord d’entreprise ou d’établissement, mention dans un contrat de travail...).